Sécurité sociale et gouvernance
Par Nicolas Da Silva , publié le 26 décembre 2023 pour Socialter
Illustration : Kévin Deneufchatel
La Sécurité sociale n’est pas la politique égalitaire et universelle que l’on croit. Notre système de santé, fruit du régime général né en 1946, a fait l’objet d’une appropriation croissante par l’État au détriment de la gestion par les intéressés. Contre cette mainmise qui a conduit à des décennies de réformes ouvrant la voie à un capitalisme sanitaire, l’économiste Nicolas Da Silva soutient, dans la lignée de son ouvrage La Bataille de la Sécu. Une histoire du système de santé (La Fabrique, 2022), la nécessité de reprendre le pouvoir sur la « Sécu ». Et il imagine des pistes pour retrouver l’esprit originel de la « Sociale », fonctionnant sur l’autogouvernement par les assurés.
Syndicats et partis politiques appellent généralement à un retour de l’État social pour lutter contre la marchandisation du monde. Je vais ici défendre une proposition à première vue scandaleuse : pour mettre un terme à l’extension du capital dans toutes les sphères de la société, je soutiens qu’il faut se battre contre le capital et contre l’État. Ce qui, concernant les politiques de santé, signifie se battre contre l’État social. En effet, à partir d’une lecture critique de l’histoire de la protection sociale, on peut montrer que le public ne se résume pas à l’étatique.
Texte à retrouver dans Bascules #3 – 10 propositions pour un tournant radical, en kiosque, librairie et sur notre boutique.
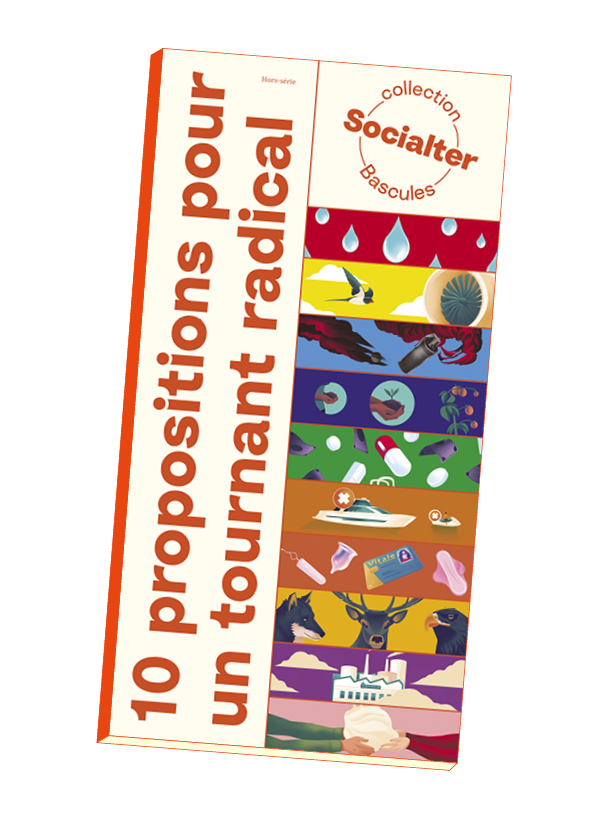
Au contraire, on peut opposer à l’État social – dirigé d’en haut – la « Sociale » qui repose sur une politique autonome, menée par les intéressés eux-mêmes. Pour saisir la portée d’un tel retournement, il est nécessaire de faire un détour par la naissance de l’État social tel que nous le connaissons aujourd’hui. Contrairement à ce que l’on pense souvent, ce moment fondateur ne doit rien au débat pacifique ou au compromis. Il est même l’enfant de la guerre. De plus en plus de travaux insistent sur le fait que ce n’est qu’avec la préparation, la conduite et les conséquences des guerres totales du début du XXe siècle que se sont développées les politiques sociales portées par les États en Europe.
En France, la question de l’implication de l’État dans la politique sociale est posée depuis la Révolution de 1789, mais jusqu’à 1914 le poids relatif des dépenses de l’État dans la richesse nationale stagne autour de 10 %. La guerre totale, qui se distingue des guerres traditionnelles par le fait que toute la société est en guerre (il n’y a plus de différence entre l’avant et l’arrière, entre le soldat et le citoyen), change le rapport entre l’État et la société. Après avoir prélevé l’impôt du sang, l’État devient donc redevable vis-à-vis de ses citoyens, en particulier les anciens combattants, les veuves et les orphelins. Alors que la guerre de 1914 a été propice aux révolutions allemande et russe, il est clair que sans politique sociale ambitieuse, les élites peuvent craindre des événements similaires en France.
C’est ce contexte qui voit l’augmentation des dépenses de l’État dans la richesse nationale qui atteint près de 30 % en 1920. Comme Frédéric Lordon le souligne, dans Figures du communisme (La Fabrique, 2021) : « Pour imposer au capitalisme des constructions institutionnelles qui le contredisent sérieusement – tout en le laissant persévérer quand même –, il a fallu une énergie de l’ordre de grandeur “guerre mondiale”. » La main gauche de l’État ne peut pas être séparée de sa main droite. C’est bien parce que l’État a conduit la population à la guerre qu’il a enfin accepté de mettre en place des politiques sociales ambitieuses, comme les lois d’assurances sociales de 1928-1930 sur la santé et les retraites. Il fallait garantir la perpétuation de l’ordre social.
1945 : la Sociale contre le paternalisme
Rétrospectivement, il est étonnant de constater qu’une grande partie de la classe ouvrière du début du XXe siècle a été très hostile aux assurances sociales qui se généralisent à ce moment-là. On comprend plus facilement cette hostilité lorsque l’on sait que ce sont les classes sociales dominantes de l’époque qui dirigent ces institutions et qu’elles en ont fait un instrument de paternalisme social et de mise en concurrence des ouvriers. Les assurances sociales de 1928-1930 sont gouvernées par l’État via les départements et via les notables mutualistes. Les allocations familiales généralisées en 1932 sont sous le contrôle du patronat avec une influence importante du clergé. Les caisses issues de la loi sur les accidents du travail de 1898 sont pilotées par le patronat et les assureurs capitalistes. L’enjeu explicite pour les classes dominantes est de moraliser la classe ouvrière, c’est-à-dire de lui faire accepter l’ordre des choses. Mais comment accepter cet ordre lorsque les assurances sociales prévoient un âge de départ à la retraite supérieur à l’espérance de vie ouvrière ? Ou lorsque l’accès aux droits est limité par une austérité de fer et une présomption de fraude généralisée ? Contre cet État social en développement, les militants exigent dès la fin des années 1920 le pouvoir sur les caisses. C’est ce qu’ils obtiendront par le conflit contre l’État en 1945-1946.
La grande originalité du régime général de Sécurité sociale n’est pas la mise en place pour la première fois d’assurances obligatoires publiques. Comme on l’a vu, il existe des caisses de ce type depuis longtemps. La nouveauté décisive est le fait que le pouvoir sur ces caisses est confié aux intéressés eux-mêmes 1. Dans les caisses du régime général, 75 % des sièges au conseil d’administration sont occupés par les représentants des salariés. Le pouvoir n’est pas descendant depuis la caisse nationale vers les caisses primaires mais ascendant ; l’autonomie au niveau local est très forte. Aussi, on peut dire qu’au sortir de la Seconde Guerre mondiale la Sécurité sociale n’est pas nationalisée – sous l’autorité du gouvernement – mais socialisée – sous l’autorité des intéressés eux-mêmes.
L’État social s’efface au bénéfice de la Sociale. Bien entendu, tout cela ne se fait pas dans un climat de compromis ou d’unanimité nationale. Le régime général est une conséquence de la guerre qui a eu pour spécificité en France de voir rapidement s’opposer un pôle collaborateur et un pôle résistant. Les militants qui ont souffert durant la guerre savent à quoi s’en tenir avec l’État. D’ailleurs, durant le processus de rédaction des ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 et dès leur mise en application, de nombreuses forces sociales se sont opposées à l’organisation démocratique de l’institution. Rien de plus normal : le patronat perdait du pouvoir, la mutualité perdait du pouvoir, l’Église perdait du pouvoir, les assureurs capitalistes perdaient du pouvoir, etc. Comment imaginer une seule seconde qu’il ait pu en être autrement ? L’espoir de contre-réforme n’attend pas le tournant des années 1980 pour se faire jour et les défaites pour le camp de la Sociale non plus.
Malgré une opposition précoce, la Sécurité sociale portée par les intéressés est déjà en mesure de changer la vie. En effet, le contrôle politique sur l’institution n’est pas qu’une caractéristique secondaire car le pouvoir permet de donner une impulsion nouvelle aux politiques sociales. Contre le paternalisme des politiques d’avant-guerre, le pouvoir ouvrier sur l’institution permet de généraliser l’accès aux droits. Des guichets de la Sécu sont ouverts un peu partout, notamment dans les entreprises, pour rapprocher l’institution des cotisants. Avec les fonds sur lesquels les caisses ont de l’autonomie, les conseils d’administration financent des œuvres sociales au plus près des besoins et désirs des intéressés. Contre toute une partie de la médecine libérale qui refuse de se mettre d’accord sur des prix, les caisses sont à l’initiative pour aider au développement de centres de santé (en prêtant ou en avançant des fonds par exemple) 2. Si l’État et le patronat pèsent de tout leur poids pour limiter les initiatives qui ne leur plaisent pas, le pouvoir acquis par la classe ouvrière à ce moment-là est inédit. Il doit être replacé dans une histoire longue durant laquelle la classe ouvrière a souvent été cantonnée à un rôle de mineur politique et économique.
Quand le capital écrase la Sociale
Le premier objectif des contre-réformateurs depuis 1946 n’est pas l’austérité – c’est-à-dire la réduction de la quantité d’argent attribuée par la Sécurité sociale. Leur premier objectif est la réappropriation de la Sécurité sociale par l’État. Dès 1949, on entend à l’Assemblée nationale des députés regretter que ce ne soit pas le gouvernement qui pilote et contrôle le budget de l’institution. Déjà toute la rhétorique que nous connaissons se met en place pour délégitimer le contrôle populaire : inefficacité, risque de dumping social dans la concurrence internationale, poids des charges pour les entreprises, abus des assurés… Malgré toute cette hargne, il faut attendre 1967 pour que soit porté un coup décisif 3. Les ordonnances Jeanneney remplacent les élections aux caisses par la désignation dans un ensemble de syndicats (jugés par l’État) représentatifs. Le nombre de sièges des représentants de salariés est réduit à 50 % (au lieu de 75 %) : on voit au passage à quel point la naissance du paritarisme est une régression démocratique.
Il faudra attendre 1995-1996 pour observer le parachèvement de l’étatisation de la Sécurité sociale 4. Alain Juppé crée à ce moment-là une série d’institutions qui renforcent le contrôle de l’État (social) : loi de financement de la Sécurité sociale, objectif national de dépenses d’assurance maladie, agences régionales d’hospitalisation (ancêtre des agences régionales de santé), contrats d’objectifs et de gestion, caisse d’amortissement de la dette sociale, etc. S’il existe encore des représentants des syndicats et du patronat dans la Sécurité sociale, ceux-ci n’ont qu’un pouvoir consultatif. L’essentiel des décisions est pris par le directeur général nommé en conseil des ministres. Les agences régionales de santé (ARS) fonctionnent quant à elles comme des préfectures de santé. Elles appliquent localement les instructions conçues au niveau national.
Et alors ? On peut en effet se demander quelles sont les conséquences concrètes de cette réappropriation. Les élites politiques et administratives ne sont-elles pas plus compétentes et légitimes pour décider de la politique de santé que les intéressés ? Encore une fois, le pouvoir sur l’institution change tout. Alors que la Sécurité sociale portée par les intéressés avait pour ambition que chacun cotise selon ses moyens et reçoive selon ses besoins, avec la prise de pouvoir par l’État le principe d’organisation change. Désormais, chacun cotise selon ses moyens (et ses capacités de détourner les prélèvements) et reçoit selon son niveau de risque 5. L’idée des contre-réformateurs à la tête de l’État social n’est pas de liquider la Sécurité sociale, mais de réduire ses ambitions en concentrant les financements vers ceux qui en ont le plus besoin. C’est ce qu’on appelle la politique de ciblage. Ainsi, il existe des dispositifs de prise à charge à 100 % pour les plus malades et pour les plus pauvres.
Les autres sont invités à souscrire à une complémentaire santé. L’État social organise de cette façon un système qui légitime le développement du capital dans le secteur des soins. Cependant, les objectifs affichés ne sont pas atteints. Les politiques de ciblage sont des paniers percés, notamment parce qu’il y a un fort non-recours aux droits. Aussi, le ciblage délite le lien social car il crée des effets de seuil : au-dessous du plafond de ressource on a des droits, au-dessus on n’a plus le droit à rien. Non seulement la politique de ciblage est en grande partie en échec, mais en plus l’État social sert de support au développement du capital en santé. C’est avec la bénédiction de l’État social que se sont développées ces dernières années les complémentaires santé, l’industrie pharmaceutique ou encore les cliniques privées à but lucratif 6. Parce que les intéressés n’ont pas le pouvoir sur la Sécurité sociale, l’État est en mesure de solvabiliser l’activité rentière de ses alliés politiques et économiques.
Reprendre le pouvoir
Alors faut-il plus d’argent pour la Sécu ? Peut-être, mais l’enjeu premier est le pouvoir. En effet, étant donné le fonctionnement actuel, plus d’argent pour la Sécu c’est probablement plus d’argent pour l’industrie pharmaceutique et plus d’argent pour les cliniques. Est-ce bien un objectif souhaitable ? Deux événements récents permettent d’illustrer à quel point le contrôle politique sur la Sécurité sociale pourrait changer la vie. Fin 2021 était lancé par Olivier Véran le débat sur la « Grande Sécu ». L’idée était d’étendre les remboursements de la Sécurité sociale à 100 % des prix administrés. Par exemple, 100 % des 26,5 euros que coûte la consultation de médecine générale (contre 70 % aujourd’hui). La critique des complémentaires est ancienne et bien connue.
D’une part, les complémentaires santé sont inégalitaires : tout le monde n’a pas de complémentaire santé et, surtout, tout le monde n’a pas la même. Or, les plus pauvres qui sont aussi les plus malades n’ont pas assez d’argent pour avoir une complémentaire couvrante et les plus riches qui sont aussi les moins malades ont des complémentaires très couvrantes qu’ils n’utilisent pas. D’autre part, les complémentaires sont très coûteuses en frais de gestion (beaucoup plus que la Sécurité sociale). Un rapport de 2022 estimait à 5,4 milliards d’euros par an les économies réalisées si la Sécurité sociale s’étendait à 100 % des prix administrés 7. Pourquoi cette réforme qui rapporte de l’argent et qui réduit les inégalités n’a pas été mise en place ? Parce que nous n’avons pas le pouvoir sur la Sécurité sociale. Les défenseurs de l’économie de rente des complémentaires sont beaucoup plus écoutés par l’État social que les classes populaires.
L’autre événement qui montre avec éclat l’importance du contrôle politique sur la Sécurité sociale est la mobilisation en opposition à la contre-réforme des retraites d’Élisabeth Borne. Il y a eu un incroyable alignement des planètes pour résister aux plans de la Première ministre. L’ensemble des syndicats se sont unis alors qu’ils ne l’étaient pas en 2019 (la CFDT acceptait la retraite par point d’Emmanuel Macron). Les sondages d’opinion ont montré avec une grande régularité que presque toute la population active et plus des deux tiers de la population totale étaient contre le projet. Des personnalités peu suspectes de radicalité, comme Pierre-Louis Bras, président du Conseil d’orientation des retraites, ont expliqué que la santé financière du système de retraite n’était pas problématique.
À l’Assemblée nationale, un vote aurait probablement rejeté la proposition du gouvernement qui n’a été sauvée que par la procédure autoritaire du 49-3. Le mouvement social a été très actif des mois durant. Et pourtant le gouvernement a pu adopter son projet seul (ou presque) contre tous. L’enjeu n’est donc pas de lutter contre telle ou telle contre-réforme mais plutôt de faire en sorte que, du fait de la démocratisation de nos institutions, ce type de contre-réforme particulièrement impopulaire ne puisse même plus être à l’ordre du jour.
En fonction de notre appétit politique, il est possible d’envisager plusieurs transformations concernant la répartition du pouvoir politique sur la Sécurité sociale. La plus modeste est d’inventer un droit de veto pour les syndicats encore présents dans la Sécurité sociale. Lorsque plus de X % des syndicats sont opposés à une proposition de réforme, alors elle tombe. Cela aurait liquidé la réforme des retraites d’Élisabeth Borne en moins de deux heures. Ce droit de veto pourrait concerner soit un nombre restreint de sujets, soit l’ensemble des décisions impactant le financement de la Sécurité sociale.
Il est important d’exiger la re-démocratisation de la Sécurité sociale avec l’élection des représentants des salariés au niveau local, régional et national. La répartition des sièges peut connaître des formats plus ou moins progressistes : paritarisme (50/50 entre salariat et patronat), 75/25 à l’avantage du salariat (comme en 1945) ou… une personne une voix (ce qui est un principe démocratique qui paraît évident). Ces élections ne doivent pas être limitées par une condition de cotisation ou de nationalité. On peut aussi imaginer une composition atypique (en dehors des seuls salariés) et un mode de sélection alternatif à l’élection (comme le tirage au sort). L’enjeu ici est de dépasser les critiques légitimes sur l’étroitesse de la base électorale des caisses de Sécurité sociale en 1945-1946.
Le retour dans l’institution n’est rien si le pouvoir consultatif n’est pas remplacé par un pouvoir délibératif. En plus des responsabilités actuelles (par exemple les négociations conventionnelles avec les médecins libéraux), les caisses pourraient être amenées à décider d’autres aspects de la politique de santé. Faut-il financer le privé à but lucratif comme le reste ? Faut-il modifier les règles de fixation du prix du médicament ? Faut-il favoriser telle ou telle forme d’organisation des soins (libéral versus salariat, hospitalisation versus soins primaires, etc.) ?
La réappropriation de la Sécurité sociale ne peut pas se faire sans avoir en tête l’existence d’un double pouvoir. Hier comme aujourd’hui le poids de l’État est très important, notamment à travers le rôle des ARS. En attendant une éventuelle démocratisation des ARS, ne faut-il pas exiger la présence des caisses de Sécurité sociale dans les ARS avec un pouvoir délibératif fort ou au moins un droit de veto ? En situation de tension sur l’usage des ressources, vaut-il mieux que l’ARS décide seule de fermer tel ou tel service hospitalier ou les caisses de Sécurité sociale ont-elles leur mot à dire ? D’autres formes de pouvoir devront être affrontées, comme les universités qui décident du nombre de professionnels de santé formés chaque année. Ne faut-il pas que les caisses aient un pouvoir sur ce sujet ô combien central ?
Un point très important est que pour financer une éventuelle augmentation de la production publique de soin, il est possible qu’une hausse du taux de cotisation soit nécessaire. Il faut alors que la Caisse nationale ait le pouvoir de moduler le taux de cotisation dans une fourchette prévisible à l’avance. Cela n’a rien d’extraordinaire puisque cela existe déjà aujourd’hui avec le régime local d’Alsace-Moselle. Ce pouvoir d’ajustement du taux de cotisation est indispensable si l’on souhaite se passer des complémentaires santé.
Ces quelques pistes offrent une perspective de long terme et permettent de sortir de l’éternelle lutte contre telle ou telle contre-réforme. L’enjeu est de reprendre le pouvoir sur la Sécurité sociale et de se placer dans la route tracée depuis deux siècles. Le régime général de Sécurité sociale de 1945-1946 n’est pas un modèle achevé. C’est un îlot sans cesse attaqué depuis sa naissance. Le contrôle politique sur les institutions de protection sociale change la vie parce qu’il permet de se passer de l’oppression de l’État et de l’exploitation du capital. L’appel à la démocratisation ne peut pas être séparé d’un rappel : le capital et l’État font toujours tout ce qui est en leur possible pour entraver des expériences qui leur échappent. On voit bien avec le cas des complémentaires santé et de la contre-réforme des retraites du gouvernement d’Élisabeth Borne que la démocratie ne compte plus dès lors qu’elle remet en cause les intérêts dominants. Contre le capital et contre l’État, il faut reprendre la bataille de la Sécu. Il faut reprendre à l’État social ce qui appartient à la Sociale. •
Pour creuser le sujet, je vous recommande de lire du même auteur: » La bataille de la Sécu «


Laisser un commentaire